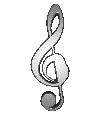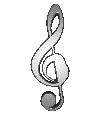|
1°)
Aux termes de la loi, qu'appelle-t-on
auteur ? La
qualité d'auteur appartient,
sauf preuve contraire, à celui
ou à ceux sous le nom de qui
l'oeuvre est divulguée.
L'auteur
peut être unique, mais plusieurs
auteurs peuvent aussi se concerter pour
aboutir à la création
d'une seule et même oeuvre, qui
sera alors dite en collobaration.
Certaines
créations constituent des oeuvres
à composantes multiples, axquelles
ont collaboré des auteurs qui
représentent des disciplines
artistiques très différentes.
Ainsi, pour la réalisation d'une
comédie musicale on distinguera
l'auteur de livret, celui de "lyrics",
le ou les arrangeurs, leurs apports
respectifs sont coordonnés par
un metteur en scène qui pourra
lui aussi obtenir la qualité
de co-auteur à la condition que
la mise en scène soit fixée
par écrit.
Dans
le cas particulier des oeuvres audiovisuelles
(cinéma, télévision)
la loi a défini précisément
les personnes qui n'ont pas à
apporter la preuve de leur qualité
d'auteur et qui sont donc présumées
l'être : ce sont le scénariste,
l'adaptateur, l'auteur des textes parlés,
le compositeur et le réalisateur.
De
plus, la qualité de co-auteur
sera étendue à l'écrivain
dont le roman ou la pièce de
théâtre encore protégés
ont été adaptés
pour les besoins de l'oeuvre cinématographique.
La
qualité d'auteur n'est pas pour
autant reconnue à toutes les
personnes qui auront participé,
par une prestation technique marquée
du sceau de leur personnamité,
à la naissance effective de l'oeuvre.
Les artistes interprètes ou exécutants,
chefs d'orchestre, musiciens, les caméramen,
les monteurs, les décorateurs
et plus largement tous ceux qui apportent
un concours à la création
vivante de l'eouvre, ne sont pas considérés,
aux termes de la loi, comme co-auteurs
de l'oeuvre de collaboration, en dépit
de l'importance que peut présenter
leur apport pour le succès de
cette oeuvre.
La
jurisprudence les considère seulement
comme des auxiliaires de la création
de l'oeuvre, et ne leur reconnaît
pas en conséquence un droit d'auteur
pour ptotéger leurs apports.
Certains sont considérés
uniquement comme titulaires d'un droit
voisin du droit d'auteur au sens de
la Convention de Rome (1961). Ce sont
les artistes interprètes ou exécutants,
à l'exclusion des simples techniciens
comme les preneurs de sons ou les caméramen.
2°)
A
quel titre l'auteur reste-t-il propriétaire
des oeuvres qu'il a créées
?
La
loi reconnaît à l'auteur
un droit personnel sur son oeuvre. Il
s'agit d'une propriété
incorporelle qui est indépendante
de la propriété du support
matériel de l'oeuvre (disque,
cassette, partition) qui appartient,
lui au fabricant de la reproduction
graphique ou sonore de l'oeuvre.
L'acquisition
d'un exemplaire ne donne donc pas lieu
à un transfert de propriété
du droit d'auteur; l'auteur, et après
lui ses héritiers, demeure toujours
propriétaire de l'oeuvre qui
est reproduite sur celui-ci.
L'acquéreur
d'un disque ou de la partition n'aura
pas le droit d'en disposer de la manière
la plus absolue, comme le propriétaire
de tout autre objet matériel,
il ne possèdera que le droit
d'utiliser l'oeuvre conformément
aux conditions très précisément
fixées par l'auteur ou la société
qu'il a chargée de le représenter
pour autoriser la fabrication et la
destination des reproductions mises
en vente auprès du public. (Voir
question N° 11).
3°)
Une
chanson bénéficie-t-elle
de la même protection qu'une symphonie
?
Oui,
car pour bénéficier de
la protection légale, il suffit
que l'oeuvre soit une création
élaborée par une personne
physique, qu'elle qu'en soit l'importance
sur le plan artistique ou intellectuel.
Le
genre de l'oeuvre n'influera en aucune
manière sur cette protection
: un peintre, un compositeur, un poète,
un compositeur, un poète jouissant
du même droit; la forme d'expression
de l'oeuvre n'intervient pas : entre
une composition notée sur le
papier et une oeuvre électroacoustique
fixée sur une bande magnétique,
il n'y aura aucune différence
dans l'attribution des droits d'auteurs
aux deux compositeurs.
Enfin,
le mérite de l'oeuvre, impliquant
un jugement sur sa qualité artistique
ne joue en sur l'étendue de la
protection conférée par
la loi du 11 Mars 1957.
4°)
La
protection que la loi assure est-elle
provisoire ?
La
loi accorde aux auteurs, pour une durée
limitée, le droit de tirer un
profit pécuniaire de l'exécution
et de la reproduction de leurs oeuvres.
La protection du droit moral est en
revanche non limitée dans le
temps.
En
France, le délai de protection
du droit pécuniaire est fixé
à 70 ans après le décès
de l'auteur; (S'il s'agit d'une oeuvre
en collabiration, la période
de protection est calculée à
partir de l'année suivant le
décès du dernier co-auteur
survivant).
Par
ailleurs, le législateur peut
tenir compte des périodes de
troubles politiques et sociaux susceptibles
de gêner l'exploitation normale
des oeuvres. C'est pourquoi des lois
spéciales ont prorogé
la période de protection pour
une durée égale à
la durée des deux conflits mondiaux.
En France une oeuvre est ainsi protégée
84 ans et 274 Jours si elle a été
publiée avant le 31 Décembre
1920.
5°)
Faut-il
qu'une chanson soit éditée
pour bénéficier de la
protection de la loi
?
Non,
il suffit qu'elle soit matérialisée
par un manuscrit ou par un support quelconque,
et qu'elle porte l'empreinte de la personnalité
de son auteur, cela même si la
réalisation de la conception
de l'auteur est demeurée inachevée,
.
Lorsque le manuscrit est déposé
au :
-
Service de la Documentation Générale,
la SACEM assure la protection des
oeuvres de ses membres sans aucun
formalité.
6°)
Une
partition composée à l'aide
d'une ordinateur bénéficie-t-elle
de la protection ?
Une
oeuvre qui serait créée
de façon purement mécanique
par la simple application d'une formule
mathématique traitée par
ordinateur ne pourrait constituer une
oeuvre protégée par le
droit de propriété littéraire
et artistique.
En
revanche, lorsque la partition est l'aboutissement
d'un ensemble d'instructions et d'organisations
développes par la machine, sous
réserve de l'intervention effective
et créatrice d'une personne physique,
l'oeuvre est protégée
dans des conditions similaires à
une oeuvre réalisée selon
les critères traditionnels.
7°)
La
loi prévoit-elle des dispositions
particulières pour les oeuvres
écrites par plusieurs auteurs
?
L'oeuvre
de collaboration est la propriété
commune des co-auteurs, selon un procédé
que les juristes désignent sous
l'appellation "indivision".
Les
co-auteurs doivent exercer leurs droits
d'un commun accord et en l'absence de
consensus il appartient aux tribunaux
de trancher le conflit qui les oppose.
Cependant
les oeuvres de collaboration, qui relèvent
de genres artistiques différents,
chaque auteur, sauf convention contraire
garde la possibilité d'exploiter
librement ou séparément
sa propre contribution dans la mesure
où cela ne nuit pas à
l'eouvre commune.
Cette
possibilité ne se réalise
toutefois que pour des oeuvres longues
dans leur durée et complexes
par la pluralité des disciplines
artistiques qu'elles mettent en oeuvre.
Le
compositeur d'une musique de film pourra,
par exemple; la faire enregistrer et
bénéficier à lui
seul des redevances provenant de la
vente de disques.
En
revanche dans le cas des chansons et
lorsque chaque co-auteur est membre
d'une société d'auteurs
comme la SACEM, les conditions d'exploitation
sont facilitées parce que le
pacte social règlemente en matière
de droit d'exécution publique
la répartition des redevances
produites par l'oeuvre commune.
Le
règlement général
de la SACEM prévoit dans son
article 56 que la répartition
se fait dans le cas des oeuvres éditées
par fractions égales.
-
1/3 pour le ou les compositeurs
-
1/3 pour le ou les auteurs
- 1/3
pour le ou les éditeurs
Bien
plus, la SACEM considère que
l'exploitation normale d'une chanson
impose une solidarité absolue
des co-auteurs, aussi un texte ou une
musique ne peuvent être exploitées
séparément par adaptations
ou arrangements sans que les auteurs
originaux ne perçoivent, eux
aussi, une part des redevances
produites par l'exécution publique
de l'arrangement d'une chanson, ou encore
de son adaptation en langue étrangère.
C'est
pourquoi, adapter, arranger, orchestrer,
nécessitent pour l'auteur un
certain nombre de précautions.
8°)
Ne
doit-on pas prendre des précautions
particulières lorsqu'on veut
écrire un arrangement ou adpater
une chanson étrangère
? Si,
pour un arrangement ou adaptation d'une
chanson - et c'est le plus souvent le
cas d'un auteur qui crée des
paroles nouvelles sur un thème
musical ou qui traduit des paroles françaises
sur le texte oroginal d'une chanson
étrangère - puissent etre
protégées par la loi,
il faut que l'arrangeur ou l'adaptateur
obtienne l'autorisation du créateur
de l'oeuvre originale, et également
du cessionnaire du droit d'exploitation
de celle-ci : éditeur ou sous
éditeur.
En
revanche, un compositeur peut fort bien,
sans demander aucune autorisation écrire
l'arrangement orchestral d'une mélodie
tombée dans le domaine public.
Les héritiers du compositeur
original ne pourront s'opposer à
l'exploitation de l'oeuvre nouvelle,
sous réserve de l'exercice de
leur droit moral. (voir question n°
9).
La
SACEM a statutairement fixé dans
son règlement général
la part des redevances qu'elle répartit
à l'arrangeur ou à l'adapteur
pour l'exécution publique. Cette
part est habituellement de :
-
2/12e pour les arrangements ou adaptations
effectués à partir d'oeuvres
protégées
- 1/12e pour
ceux qui ont été réalisés
d'après des oeuvres tombées
dans le domaine public.
Cependant,
pour qu'un arrangement ou une adaptation
puisse être protégé,
il faut que leurs auteurs fassent la
preuve de la réalité de
la création personnelle qu'ils
ont apporté à l'oeuvre
antérieure.
Aussi,
la commission des compositeurs de la
SACEM se reserve-t-elle le droit, dans
le cas par exemple d'instrumentation
d'oeuvres anciennes, de refuser les
simples transcriptions par passage d'une
clé, d'une tonalité dans
une autre.
9°)
Qu'appelle-t-on
droit moral des auteurs ?
Les
auteurs, nous l'avons vu précédemment,
sont titulaires sur les oeuvres de droits
patrimoniaux, ils le sont également
de 4 prérogatives distinctes,
qui constitue le droit moral :
a)
l'auteur a seul le droit de divulguer
son oeuvre
Le
libre choix de la divulgation, c'est-à-dire
du moment où l'auteur décide
que son oeuvre est achevée et
qu'elle peut être communiquée
au public.
Aussi,
un organisateur de spectacles, un éditeur,
un organisme commanditaire ne pourront-ils
contraindre l'auteur à remettre
l'oeuvre achevée dans les délais
prévus par le contrat, si l'auteur
ne l'estime pas parfaite.
Cependant,
en cas d'inécution totale ou
même partielle de la commande,
le juge saisi du litige pourra
résilier le contrat de condamner
l'auteur à verser des dommages
et intérêts à son
contractant.
Dans
le domaine de l'audiovisuel (cinéma,
radio, télévision, etc...),
les oeuvres nécessistent, en
général des investissements
importants, l'auteur ne pourra pas s'opposer
à l'utilisation par le producteur
de sa contribution, même inachée.
Il aura pour son apport la reconnaissance
de la qualité d'auteur et jouira
des droits qui en découlent.
b)
il a sur son oeuvre un droit de respect
Cela
signifie qu'il peut s'opposer à
l'exploitation de son oeuvre s'il prouve
que celle-ci a subi des modifications,
des coupures, sans autorisation préalable,
ou toute autre dénaturation.
c)
et un droit de paternité,
c'est-à-dire de signature
Ce
droit permet à l'auteur d'interrompre
les effets pour toute utilisation publique
de l'oeuvre par des tiers, dans un but
commercial ou non, d'indiquer clairement
le titre de l'oeuvre ou le nom de l'auteur.
Celui-ci, s'il juge nécessaire,
peut recourir à un pseudonyme
ou encore garder l'anonymat.
d)
le droit de repentir ou de retrait
Ce
droit permet à l'auteur d'interrompre
les effets d'un contrat d'exploitation,
même conclu valablement avec un
organisateur de spectacles ou un éditeur.
Cependant cette possibilité de
repentir ou de retrait est assortie
d'une condition limitative très
importante : l'indemnisation préalable
du préjudice ou du manque à
gagner subis par l'exploitant en raison
de l'arrêt de la diffusion de
l'oeuvre.
Par
ailleurs, si l'auteur décide
de réintroduire son oeuvre modifiée
dans le circuit commercial, il est
tenu de présenter la version
nouvelle au cessionnaire qu'il avait
originairement choisi et eux conditions
financières primitivement définies.
Ces
4 prérogatives sont attachées
à la personne de l'auteur, qui
ne peut s'en déssaisir. C'est
l'inaliénabilité du droit
moral.
Après
son décès, seuls les droits
de divulgation, au respect de l'eouvre
et à la paternité sont
transmis aux héritiers ou à
l'exécuteur testamentaire spécialement
désigné par l'auteur,
et ceci au-delà de la période
de protection prévue par les
droits patrimoniaux (voir question n°
4).
C'est
pourquoi le droit moral est dit perpétuel,
inaliénable et imprescriptible.
10°)
Par
quels moyens l'auteur pourra-t-il exploiter
son oeuvre ?
Les
auteurs sont titulaires sur leurs oeuvres
de droits patrimoniaux relatifs à
la représentation et à
la reproduction de celles-ci, toujours
sous réserve du respect de leurs
prérogatives intellectuelles
ou morales.
"La
représentation consiste en
la communication directe de l'oeuvre
au public. (Extrait de l'article 27),
et le droit de représentation
implique que l'eouvre ne peut être
représentée ou exécutée
en oublic sans l'autorisation de l'auteur
ou de ses mandataires.
Il
s'agira, soit d'une communication directe
et vivante par des interprètes
au cours des concerts, bals, galas,
soit d'une communication au moyen d'un
support sonore, lors de l'audition publique
d'un disque, la projection publique
d'un film, les diffusions radiophoniques
ou télévisuelles.
La
reproduction consiste dans la
fixation matérielle de l'oeuvre
par tout procédé qui permet
de la communiquer au public d'une manière
indirecte.
Ces
procédés sont par exemple
le disque, le cd, la bande magnétique,
la cassette; les enregistrements sonores
ou visuels destinés à
la radiodiffusion, à la télévision,
au cinéma, les reproductions
audiovisuelles par vidéocassettes
et vidéodisques.
Quant
au droit de reproduction, il prévoit
également l'autorisation préalable
de l'auteur ou de ses ayants droit pour
toute fixation matérielle sur
les supports que nous venons d'énumérer.
Les
droits de représentation et de
reproduction sont exclusifs et opposables
à tous : organisateur, exploitants,
organismes de radiodiffusion, fabricants
d'enregistrements, particuliers.
L'auteur
ou l'organisme mandaté par lui
peuvent céder à l'exploitant
tout ou partie de ces droits, mais dans
des conditions et pour une durée
limitativement déterminées
qui doivent être mentionnées
dans un contrat passé par écrit,
(voir question n° 11).
Ainsi
seul ou par le canal de sa société
d'auteurs, le compositeur pourra céder
le droit d'exploiter ses oeuvres à
une maison de disques, cette firme n'aura
pas pour autant le droit d'enregistrer
ses oeuvres sur la bande sonore d'un
film, cette nouvelle exploitation devra
l'objet d'un contrat distinct.
De
même, lorsqu'un spectacle de variétés
donné en public est retransmis
par un organisme de télévision,
qu'il peut être reçu au
moyen d'un appareil placé dans
un lieu public, nous sommes en présence
de 3 représentations simultanées
de l'eouvre pour lesquelles 3 autorisations
distinctes sont indispensables. Chaque
représentation donne prise de
droit d'auteur. Les conditions de fonctionnement
du marché musical sont devenues
si complexes que les auteurs sont pratiquement
incapables de contrôler toutes
les représentations de reproductions
dont font l'objet leurs oeuvres.
C'est
pourquoi, bien que rien ne les oblige,
ils confient la défense de leurs
droits à des sociétés
structurées et outillées
spécialement pour mener à
bien ce travail.
11°)
L'exploitation
des oeuvres est-elle, au niveau des
contrats, réglementée
par la loi ? Par
son adhésion à la SACEM,
l'auteur réalise le transfert,
en favuer de sa société,
de certaines des prérogatives
que la loi lui reconnaît sur ses
oeuvres actuelles ou futures, dans tous
les genres relevant du répertoire
de la société. Ce transfert
est l'apport à la SACEM du "droit
d'autoriser ou d'interdire l'exécution
publique et le représentation
de l"oeuvre".
C'est
à ce titre que la société
intervient en lieu et place de ses adhérents
pour assurer les opérations de
perception, de contrôle et de
répartition des redevances qui
ont la contrepartie. Les membres de
la SACEM se trouvent ainsi protégés
contre toute tentative de représentation
ou de reproduction illicite de leur
répertoire.
La
loi règlemente d'une part le
contrat général de
représentation. C'est le
contrat par lequel un organisme professionnel
d'auteurs, tel que la SACEM, autorise
un entrepreneur de spectacles (autrement
dit un usager du répartoire)
à représenter pendant
la durée du contrat, les oeuvres
constituant le répertoire social
aux conditions déterminées
par l'auteur ou par ses ayants droit.
Ce
contrat est toujours conclu pour une
durée limitée et pour
un nombre déterminé de
communications publiques. Il ne prévoit,
sauf convention contraire, aucun monopole
d'exploitation à l'usager, qui
sera de fait en concurrence avec d'autres
professionnels.
Le
contrat oblige par ailleurs l'usager
à déclarer le programme
exact des représentations qu'il
a organisées, mais aussi l'état
justifié de la recette de la
séance, enfin l'entrepreneur
de spectacles est tenu d'acquitter le
montant des redevances prévues
par le contrat en contrepartie de l'utilisation
des oeuvres (voir question n° 12).
Le
contrat d'édition sonore
se rapproche à bien des égards
du précédent, il est comme
lui du domaine de sociétés
d'auteurs, il permet au fabricant de
disques, de CD, de cassettes de reproduire
toutes oeuvres appartenant aux répertoires
des sociétés pour lesquelles
la SDRM a reçu mandat de gestion.
Le
contrat d'édition graphique est
signé, quant à lui, entre
l'auteur et le compositeur d'une part
et un éditeur d'autre part, les
partenaires, dans le cas des oeuvres
musicales, sont membres de la SACEM.
Ce
contrat comporte une cession des droits
de propriété en contrepartie
de laquelle l'éditeur s'engage
à assumer la publication et la
diffusion de l'oeuvre, conformément
aux usages de la profession (Article
48).
Comme
nous l'avons vu, l'auteur a fait apport
à la SACEM des droits d'autoriser
ou d'interdire l'exécution publique
et le reproduction mécanique
de ses oeuvres, la cession qu'il accorde
à l'éditeur ne visera
en pratique que le droit d'édition
graphique, exercé sans restriction,
celui de délivrer des autorisations
d'adaptation ou d'arrangement, et la
seule jouissance du droit d'exécution
publique et du droit de reproduction
mécanique, les sociétés
d'auteurs en assumant la gestion.
Toutefois,,
si les droits de représentations
ou de reproductions ne sont pas compris
dans la cession, l'éditeur véritable
partenaire du créateur dans l'exploitation
publique de l'oeuvre, a ainsi vocation
à recevoir une partie des droits
perçus et répartis par
les sociétés d'auteurs.
Les
droits de représentation sont
répartis par parts égales
selon une clé statutaire (voir
question n° 7), mais en ce qui concerne
les droits phonographiques, le partage
est fixé librement par les partenaires
dans le contrat d'édition, il
est en général effectué
par moitié entre les créateurs
d'une part et l'éditeur d'autre
part, mais il ne s'agit pas toujours
d'un contrat particulier établi
entre les ayants droit.
12°)
Comment
est calculée la rémunération
des auteurs ?
La
loi sur la propriété littéraire
et artistique prévoit l'autorisation
préalable de l'auteur (ou de
la société qui la représente)
pour toutes les exécutions publiques
ou reproductions mécaniques de
son oeuvre.
En
contrepartie de cette autorisation,
l'usager est tenu de verser une redevance
au profit de l'auteur ou de ses représentants.
Le montant de celle-ci, déterminé
par un contrat préalable, (voir
question n° 11) est en général
proportionnel aux recettes provenant
de la vente ou de l'exploitation de
l'oeuvre.
Cette
règle a été instituée
afin de mettre un terme à certaines
pratiques selon lesquelles l'auteur
pouvait céder son oeuvre, moyennant
une somme forfaitaire. Le pourcentage
de la redevance de droits d'auteurs
fixé par la SACEM varie selon
l'importance de l'apport de l'oeuvre
exécutée ou reproduite.
-
Disques ou CD de variétés
: 8% du prix de vente du détail
-
Bals, concerts, galas avec entrées
payantes :
* 8,80% sur les recettes
directes (entrées)
* 4,40%
sur les recettes indirectes (consommations,
...)
-
manifestations ou établissements
sans prix d'entrée : 6,60%
sur la totalité des recettes.
-
cirques : 3,30% des recettes.
-
cinéma : 2,20% des recettes
brutes.
les sociétés nationales
de radio et de télévision
à caractère de service
versant globalement aux sociétés
d'auteurs (SACEM, SACD, SGDL? SDRM),
au titre de tous les droits de celle-ci
leur confère :
* 4,50% du
produit brut hors taxes des redevances
radiophoniques et télévisuelles
*
4,16% du produit des recettes publicitaires.
Dans
certains cas, la rémunération
est évaluée forfaitairement.
a)
lorsque les conditions de l'exploitations
rendent impossible l'application du
principe de la rémunération
proportionnelle. C'est le cas par exemple
des concerts ou des bals gratuits, où
l'exécution musicale ne donne
pas lieu à des recettes directes
ou indirectes.
b)
lorsque l'utilisation de la musique
n'est pas directement indispensable
à la marche de l'établissement
sonorisé, il ne peut y avoir
de liens directs entre la recette globale
de l'établissement et les droits
d'auteurs qui sont alors calculés
selon les caractéristiques d'utilisation
de la musique, pour un mgasin sonorisé,
le forfait est établi d'après
la superficie, le nombre d'employés,
l'importance de l'agglomération.
13°)
Dans
quel cas le droits d'auteurs ne sont-ils
pas perçus ?
Trois
conditions distinctes doivent impérativement
être réunies pour que la
perception d'un oeuvre ne donne pas
lieu à la perception de droits
d'auteurs : il faut que celle-ci soit
à la fois privée,
gratuite et qu'elle reste exclusivement
dans les limites du cercle de famille.
Cette
dernière notion est très
restrictive, elle exclut par exemple
les membres d'une association ou d'un
club, les lycéens ou militaires
réunis dans un foyer...
Par
ailleurs certaines reprodcutions d'oeuvres
échappant à l'autorisation
de l'auteur et ne donnent pas lieu à
la perception de droits : ce sont les
copies réservées strictement
à l'usage privé du copiste
et non destinées à une
utlisation collective et/ou commerciale.
Toutefois, une perception forfaitaire
a lieu sur les supports vierges.
Cette
disposition légale était
parfaitement cohérente à
une époque où les opérations
de duplication, encore rares et onéreuses,
se rapportaient essentiellement à
des utilisations à but éducatif
et scientifique, elle est aujourd'hui
à la fois périmée
et dangereuse car elle ne tient aucun
compte de l'énorme développement
du marché des duplicateurs (enregistreurs
à bandes et à cassettes,
graveurs de CD, graveurs de DVD. Elle
est la cause d'un préjudice financier
et moral considérable puisqu'actuellement
plusieurs dizaines de millions d'enregistrements
d'eouvres sont réalisées
chaque année en France sans compensation
aucune pour leurs créateurs et
interpètes. Cette dernière
ligne à reconsidérer depuis
la mise en place de la taxe forfaitaire
sur le ssupports vierges (cassettes
vidéo, CD et DVD etc...).
Ainsi,
les adhérents de la SACEM ont-ils
unanimement voté, au cours des
derniers temps, une résolution
demandant au Gouvernement de préparer
une législation réparant
ce préjudice. Elle est actuellement
en vigueur sous la nom de la dénomination
de la commission "Brun-Buisson".
14°)
La
SACEM peut-elle intervenir pour faciliter
la diffusion de l'oeuvre d'un de ses
membres
?
En
aucun cas, la jurisprudence distingue
précisément les conditions
d'exploitation des oeuvres, les conditions
de perception des revenus provenant
de cette exploitation.
Les
premières doivent être
assurées par des professionnels,
qu'ils soient éditeurs graphiques,
phonographiques, organisateurs de spectacles,
organismes de diffusion, etc...
Les
autres sont exclusivement assumées
par des sociétés d'auteurs,
la SACEM ne peut en aucune manière
se substituer aux professionnels pour
assurer direcetement ou même indirectement
une exploitation des oeuvres dont les
créateurs ne lui ont cédé
que des prérogatives d'ordre
juridique.
|